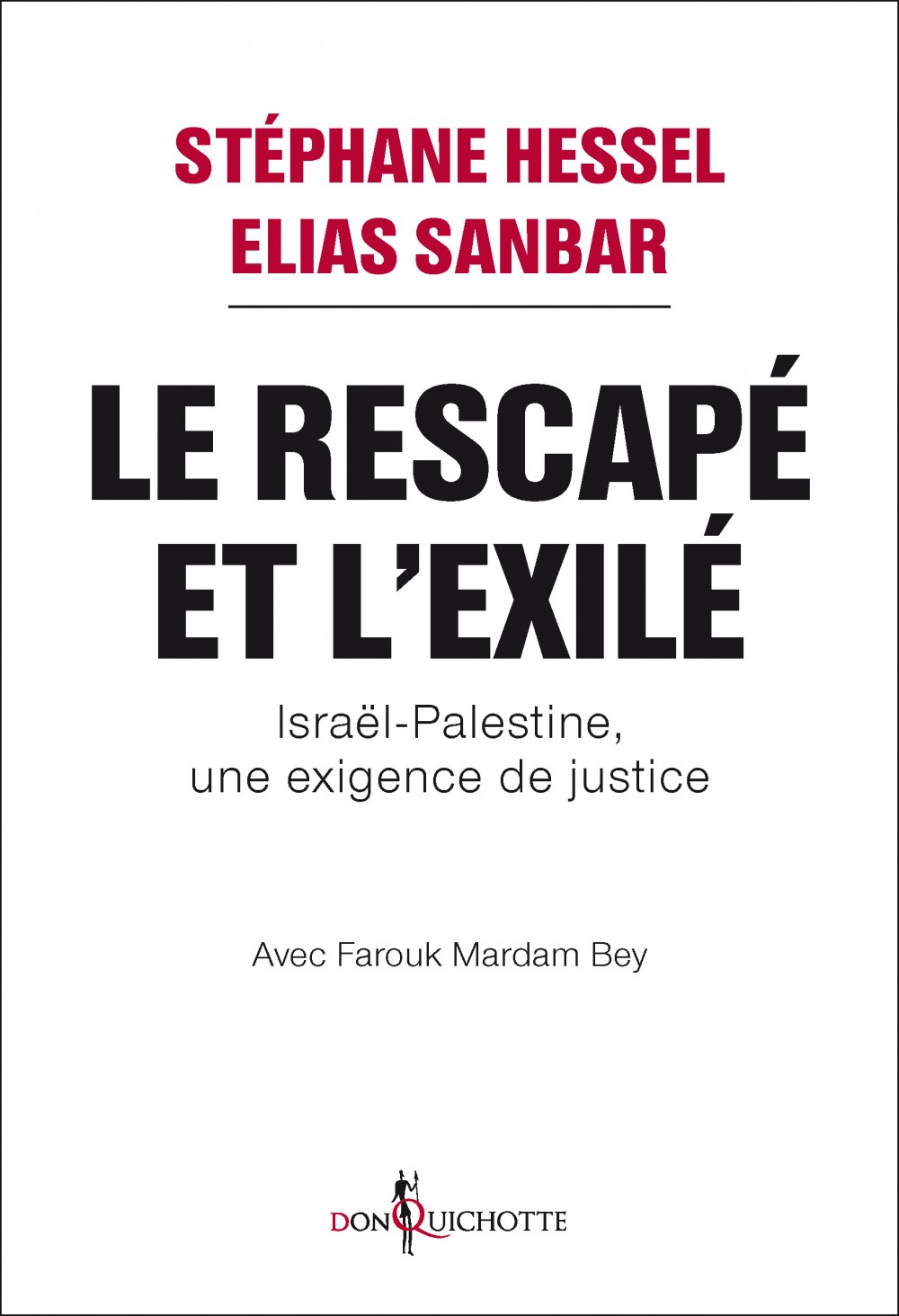Stéphane Hessel et Elias Sanbar
Le Rescapé et l'ExiléEssai
Don Quichotte Editions
16 € - 192 pages
Le livre
Que peut-on dire de nouveau sur un conflit plus que centenaire, déjà amplement documenté et étudié, et dont les paramètres de solution sont aujourd'hui connus et reconnus par l'ensemble de la communauté internationale ?
Stéphane Hessel et Elias Sanbar se sont d'emblée accordés sur une démarche originale : retracer et analyser le cours des événements qui ont conduit à l'actuelle impasse (en se fondant chacun sur sa propre expérience pour expliquer son engagement et son évolution quant à l'approche de ce long et douloureux conflit), et s'interroger sur le rapport entre légalité internationale et justice historique. Tous deux reviennent ainsi au cours de leur dialogue, dans le même souci de combiner témoignages et réflexions, sur les grandes dates du conflit, à commencer par la création de l'État d'Israël en 1948, dans un contexte géopolitique de guerre froide évidemment particulier, et la disparition de la Palestine. Croisant leurs regards, ceux de deux hommes d'origines, de générations et de formations distinctes, les auteurs relatent d'abord leurs guerres de 1947-1948, conséquence du vote du partage par l'ONU en novembre 1947, et de la proclamation de l'État d'Israël en mai 1948.
Le premier, Stéphane Hessel, ancien résistant et déporté à Buchenwald, était à l'époque diplomate en poste au siège de l'ONU à New York ; il explique pourquoi il était favorable à la création d'Israël : « Nous pensions que cette grande religion avait cessé de disposer de lieux où ils auraient été vraiment chez eux. » Face à « la barbarie nazie, perçue comme la quintessence du mal, la réponse adéquate [la création d'Israël] devenait une quintessence du bien [...] et c'est ce qui fait que tous ceux qui s'y opposaient se retrouvèrent dans le camp du mal. » D'où son soutien net et franc à la décision de l'ONU. En outre, le projet sioniste avait cela de fort qu'il présentait la création de l'État d'Israël en Palestine comme une restauration d'un État préexistant, mais disparu. Cette mythologie du retour des Juifs dans leur terre historique a faussé la donne dès le départ : puisque les Juifs rentraient chez eux, après bien des malheurs, les Palestiniens devaient partir.
Elias Sanbar, quant à lui, n'était encore qu'un enfant, né à Haïfa un an seulement avant la guerre. Il s'est aussitôt retrouvé, avec les siens, sur les routes de l'exil. « Je ne pouvais concevoir que cette chose qui se soit passée si loin [l'extermination des Juifs d'Europe par le régime nazi et ses complices] ait pu justifier mon exil, le fait que, moi, je me trouvais à Beyrouth et pas chez moi. » À cette époque, les Palestiniens n'existaient pas pour le monde occidental, il n'y avait, dans cette région, que des Jordaniens, des Libanais ou des Syriens. De plus, les territoires cédés aux Juifs étaient des colonies de l'empire britannique, puissance coloniale de la région. Selon cette idée, qu'Elias Sanbar analyse comme une sorte de myopie, les Arabes de Palestine, colonisés par l'empire britannique, ne faisaient pas de concession puisque seuls les Britanniques pouvaient céder une partie de leurs territoires. C'est pourquoi, paradoxalement, ce conflit a permis au peuple palestinien de s'affirmer, obligé qu'il était de défendre avec virulence son existence, son identité et surtout son nom, pour sortir de l'oubli où on l'avait plongé et qui a facilité la dépossession de leur terre, considérée dès lors comme vide : « Nous sommes des disparus, nous ne sommes pas des occupés. » Le peuple palestinien n'était en effet pas occupé, mais chassé, puis réfugié dans les pays arabes des alentours. Et, de fait, un peu oublié dans le contexte de la guerre froide et des pressions, ce qui a permis à Israël de poursuivre son expansion. La Palestine des premières années de guerre était vécue comme « un trou noir ». « Si l'on voulait résumer le mouvement de libération national palestinien, c'est un combat acharné pour retrouver une visibilité et réimposer la présence de son nom : Palestine, Palestiniens. C'est fait. » La Palestine est en effet définie par les résolutions 242 et 338.
Hessel et Sanbar s'attardent sur la suite du conflit, qu'ils recadrent dans la situation du Proche-Orient dans les années cinquante et soixante, avec l'avènement de Nasser, en revenant sur les différents textes de loi, traités, conventions, résolutions, etc. qui l'ont jalonné et qui, espèrent-ils, finiront par être appliqués. Ils analysent le subtil découpage du territoire entre 1948 et 1967, conduisant à la guerre des Six Jours – qui coïncide avec le vingtième anniversaire d'Elias Sanbar, qui raconte la mort de son père, d'une crise cardiaque, deux jours après la défaite de Karameh, en mars 1968. Puis viennent l'occupation et la colonisation de la Cisjordanie, de la Bande de Gaza et de Jérusalem-Est, la naissance de la résistance palestinienne, après la déroute de 1967, et la mise sur le devant de la scène du terrorisme, le déclenchement et le blocage du processus de paix, malgré, de la part des Palestiniens, la reconnaissance des Israéliens, mais non pas d'Israël, et la proposition, en 1969, alors que tout le monde est en guerre, d'un projet de vie en commun, hélas très vite suivie, en 1970, du fameux Septembre noir, puis, en 1973, la guerre de Kippour.
Les deux hommes s'attachent à retracer les changements d'attitude du monde extérieur, notamment avec les deux intifadas, différentes dans leur nature et leurs effets : la première, faisant apparaître les images d'enfants se battant à coups de cailloux face à des chars israéliens, a largement contribué au changement d'opinion qui s'est opéré en faveur des Palestiniens. La seconde, en revanche, a eu moins d'impact, puisqu'elle mettait à l'oeuvre des hommes en armes.
De son côté, Stéphane Hessel dit que, lui aussi, a changé d'opinion et explique les raisons qui l'ont conduit à reconsidérer son soutien inconditionnel à Israël après 1967 et la guerre des Six Jours quand, selon lui, l'argument de légitime défense brandi par Israël ne tient plus : « Là, ce n'était plus l'État d'Israël né d'une décision de l'ONU en 1947, d'une décision de partage et de la guerre de 1948, mais c'était un État qui, quelques mois après l'annexion de Jérusalem, capitale éternelle d'Israël, annonce l'annexion du Golan syrien, donc se situe en dehors de la légalité internationale. » Il pointe ainsi du doigt l'impunité d'Israël qui se fait jour à l'époque (et dont le pays a conscience et joue à l'envi) ainsi que son arrogance : Israël ne suit aucune des décisions de l'ONU qui oeuvre pour la résolution pacifiste du conflit et se place, en continuant à coloniser des territoires d'une main tout en signant des traités de paix de l'autre, dans l'illégalité par rapport au droit international. Plus tard, ce sont les liens d'Israël avec les oligarchies financières du monde entier, leur mainmise sur le conflit, qu'ils aiguillent selon leur convenance, qui indignent Stéphane Hessel : « Je n'avais pas soupçonné la force extraordinaire de nos vrais ennemis, qui sont des oligarchies financières et économiques pour lesquelles ce qui compte, c'est de pouvoir continuer de faire des profits », notamment des conflits.
Pour les deux auteurs, la question qui se pose, fondamentalement, c'est de savoir si Israël veut vraiment la paix : sa demande d'homogénéité politique à la Palestine, préalable à toute réconciliation, qu'eux-mêmes ne connaissent pas (il suffit de voir les mouvements radicaux dont les élus siègent à l'Assemblée israélienne) jette un doute sérieux sur leur sincérité. Mais, surtout, ils s'interrogent sur la possibilité même de cette paix, quand plusieurs générations
ont été élevées dans la peur du voisin arabe malintentionné, face auquel la seule solution proposée est de rester soudés, en votant massivement pour le parti colonisateur au pouvoir en Israël.
Toutefois, Israël n'est pas le seul objet d'interrogation : Stéphane Hessel et Elias Sanbar doutent si un État palestinien, même petit, est possible, même si le peuple a déjà accepté que leur État ne recouvrira qu'une petite partie (22 %) du territoire historique de leur patrie – ce qui, il faut le rappeler, est une énorme concession.
Pour conduire leur réflexion, ils analysent les notions clefs, nécessaires pour comprendre ce conflit, toujours en résonance avec quelques grands questionnements du monde contemporain : que signifie le partage d'un territoire ? Peut-on comparer les malheurs de deux peuples ? Faut-il accorder les mêmes droits aux victimes et à leurs descendants ? Comment un peuple peut-il se définir sans terre ? Un État réside-t-il simplement dans ses institutions ? Qu'est-ce que la souveraineté d'une nation ? Où finit la résistance, où commence le terrorisme ? La violence peut-elle être légitime ? Si elle est légitime, est-elle utile pour autant ? Y a-t-il un bon et un mauvais usage de la mémoire ? Quels sont les liens que le politique doit entretenir avec l'éthique ?
En analysant les causes du conflit et les éléments qui, jusqu'à présent, ont empêché les négociations d'aboutir, Stéphane Hessel et Elias Sanbar parviennent à trouver encore des raisons d'espérer. C'est qu'ils considèrent que la solution doit advenir de l'extérieur, tout comme le conflit a d'ailleurs été souvent entretenu par le monde extérieur défendant ses intérêts plutôt que le bien public. Un changement de vision s'impose donc. Les grandes puissances du monde moderne doivent tout d'abord abandonner leur lâcheté politique, qui consiste à ne pas dépasser le stade du « les torts sont partagés, il y a des méchants partout, que pouvons-nous faire ? »
Ils en appellent à sortir le conflit de son caractère exceptionnel, relayé par l'Occident, de bataille pour une terre sainte, trop lourd à porter, à refuser de prendre en considération les « sensibilités » des parties en jeu, qui ne devraient rien avoir à faire avec la négociation d'un traité de paix, et prônent un retour à la banalité. À cette condition seulement la justice pourra être la même pour tous, Israël sortira de son impunité et de son arrogance. Selon Elias Sanbar, « les Palestiniens ne doivent pas être chargés d'une mission impossible, qui est celle de réconforter les Israéliens et les Juifs en général de ce qui leur est arrivé. Personne n'arrivera à le faire », car le traumatisme est trop lourd. Aussi Stéphane Hessel et lui choisissent-ils de considérer la guerre israélo-palestinienne telle une banale dispute de territoires, comme le monde en connaît tant d'autres.
Sur la possibilité même d'un État palestinien, ils posent comme préalable le retrait des colonies en Cisjordanie, comme cela a été déjà le cas à Gaza. Ils préconisent surtout de travailler à former une région forte, à l'intérieur de laquelle tous les pays auraient un rôle à jouer et où Israël et la future Palestine pourraient vivre ensemble sereinement, comme cela fut le cas pour la France et l'Allemagne après la guerre de 1945, où la construction de l'Europe a facilité les rapports des deux pays. Surtout, il faut continuer à réclamer de petites choses concrètes, pour permettre un bon voisinage, envisageable même avant la réconciliation.
Elias partage ainsi l'espoir de tout son peuple, qui, dit-il, même après la Naqbah (l'expulsion massive des Palestiniens de leur pays), y compris quand ils se sont retrouvés hors de leurs frontières, n'a jamais voulu se résoudre au fait que leur situation de déplacés soit définitive : ils ne peuvent se l'imaginer, leur terre n'est pas pour toujours perdue. Il assure également, si l'on en doutait, que dans la société palestinienne, ce n'est pas la haine qui est à l'oeuvre, seulement une réaction normale face à l'adversité. Stéphane Hessel en appelle au réveil du peuple israélien, qui ne doit pas perdre la foi en un avenir heureux et rayonnant du judaïsme. Mais pour ce faire, Israël doit renoncer à sa politique meurtrière et arrogante qui, un jour, risque de devenir irréparable : « L'impunité, c'est une chose, mais la respectabilité, c'en est une autre. » Ainsi l'auteur d'Indignez-vous envisage-t-il une solution dans la foulée du printemps arabe : le réveil du peuple israélien, qui sortirait de la peur du monde extérieur entretenue par leurs dirigeants mal intentionnés : « Je crois que la solution ici, comme au Soudan Sud ou en Birmanie, dépend de la prise de conscience parmi les citoyens du monde et les politiques que les citoyens du monde sont prêts à mettre à la tête de leur État, d'une vision nouvelle, harmonieuse et équilibrée, [...] avec un droit international fort. » Un mouvement poético-culturel, en d'autres termes, pour fonder un monde harmonieux et équilibré.
Hommes de culture, férus de poésie et de musique, Stéphane Hessel et Elias Sanbar débordent aussi dans ce livre le cadre strictement politique de la question palestinienne et du conflit israélo-arabe pour proposer une vision humaniste de l'avenir qui exige, au-delà de la conclusion d'un traité de paix, une véritable réconciliation entre Palestiniens et Israéliens, et plus généralement entre Juifs et Arabes.
Les auteurs
Ambassadeur de France, témoin privilégié lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Stéphane Hessel est notamment l'auteur du célèbre Indignez-vous. Il a été le chef de la coopération technique au Quai d'Orsay.
Elias Sanbar, ambassadeur de la Palestine auprès de l'Unesco, a participé aux négociations de paix israélo-palestiniennes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Palestine et négociateur et animateur de la Revue d'études palestiniennes aux éditions de Minuit. Il est aussi négociateur aux pourparlers bilatéraux et multilatéraux de paix, et chef de la délégation palestinienne aux négociations sur la question des réfugiés.Les échanges ont été menés par l'historien et éditeur Farouk Mardam Bey.